Les membres de l’Afas publient régulièrement des notes de lectures. Elles sont à retrouver ici.
Valérie L’Hostis et Damien Féron
(EDP Sciences, Collection Bulles de sciences, 2019, 104 p. 14€)
 C’est un livre assez court édité par EDP Sciences, gage de qualité scientifique, dans la collection Bulles de sciences, gage de pédagogie, et, effectivement, le contrat est bien rempli.
C’est un livre assez court édité par EDP Sciences, gage de qualité scientifique, dans la collection Bulles de sciences, gage de pédagogie, et, effectivement, le contrat est bien rempli.
A la lecture, on voit de manière évidente ce que rencontrent tous les auteurs de livres, scientifiques ou pas : c’est l’éditeur qui choisit le titre et la couverture. De tour Eiffel, en effet, il n’est question que pages 55 et 57.
Mais cela ne restreint pas l’intérêt du livre qui est une vulgarisation d’un problème de portée industrielle considérable : la corrosion. Les phénomènes récents (effondrement du pont de Gênes, affirmation récente que 25 000 ouvrages d’art sont menacés en France..) montrent la portée vitale de la dégradation des objets sous l’effet de la rouille notamment.
Les auteurs ont choisi une pédagogie par analogie : représenter les espèces chimiques (métal, oxygène, eau...) par des coureurs de stade. Pourquoi pas ? Evidemment, connaître un peu de chimie aide bien la compréhension.
Le livre recense de manière fort utile les divers mécanismes de corrosion par l’oxygène, l’eau, les chlorures, etc., et aussi les parades possibles : passivation, peinture (la tour Eiffel !), courants de protection, anodes sacrificielles... Si ce livre pouvait susciter des vocations d’électrochimistes chez nos jeunes étudiants, nul doute qu’il rendrait un fieffé service à l’industrie de notre pays. A voir !
Pour la tour Eiffel en revanche, il faudra se référer à Internet et comprendre pourquoi il faut refaire la peinture alors qu’en fait, on ne fait que peindre par-dessus la couche précédente.
Thomas Heams
(Seuil, 2019, 192 p. 20€)
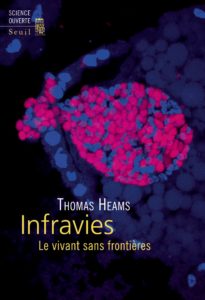 Le récit biblique de l’apparition, dans la boue, du premier être humain est de l’ordre du mythe.
Le récit biblique de l’apparition, dans la boue, du premier être humain est de l’ordre du mythe.
Le récit moderne, qu’on dit scientifique, de l’apparition, dans la soupe primitive, du premier être unicellulaire est tout autant de l’ordre du mythe.
Ces deux récits sont semblablement fallacieux : il n’y a pas eu plus de première cellule vivante que de premier être vivant, il n’y a pas eu, il n’y a jamais eu apparition de la vie, il y a eu évolution continue ; conformément à la théorie darwinienne extrapolée au minéral, il y a continuité entre l’inerte et l’animé, entre le minéral et le biologique, entre le non-vivant et le vivant.
« L’homme n’est jamais apparu, la vie n’est jamais apparue » : la formule choque, elle est contre-intuitive, elle est juste pourtant. Elle ne signifie pas que l’homme ni la vie n’existent, elle signifie que face au continuum qui va du caillou à la vie, de la vie à l’être humain, toute frontière ne saurait être qu’une commodité arbitraire.
C’est là le regard que l’auteur, Thomas Heams, maître de conférences en génomique animale à AgroParisTech et chercheur à l’Inra, nous invite à adopter.
Aucune frontière entre le non-vivant et le vivant : un immense domaine que Thomas Heams nomme les infravies, faites de toutes les formes d’infravivant.
Il n’y a pas de nouveauté à proprement parler dans cette façon de voir. L’auteur part d’acquis bien établis sur les divers composants des tissus et organes et sur leurs innombrables modes d’interaction. Il s’agit bien pourtant d’un regard neuf.
Car les infravies ne sont pas seulement une étape chronologique ayant permis le passage du non-vivant au vivant et, en tant que telles, appartenant au passé, elles sont présentes aussi ici, maintenant, partout, elles participent à la vie, elles lui sont indispensables. « Le bestiaire infravivant existe bel et bien, il est même d’une incroyable richesse ».
Un exemple : les virus. Porteurs d’information génétique, ils peuvent être classés dans le monde vivant. Dénués de tout métabolisme propre, de toute autonomie, dépendants des cellules qu’ils parasitent, ils ne sauraient être considérés comme pleinement vivants. Ils sont infravivants, le vivant ne saurait se passer d’eux.
De multiples autres exemples sont donnés dans l’ouvrage, plus surprenants les uns que les autres, pour le profane en tout cas. A l’intérieur de chaque organisme, chaque composant, vivant ou infravivant, a son génome ou fragment de génome, résultant de son histoire et de combinaisons passées, les uns et les autres se combinant et recombinant sans cesse, au gré des circonstances, en fonction du milieu...
Une telle approche conduit à voir le vivant autrement, non plus comme une catégorie nettement délimitée, porteuse d’ordre, d’organisation, en équilibre statique, mais bien comme le résultat d’un déséquilibre permanent, en perpétuelle transformation. Elle conduit, pour reprendre la formule ultra-condensée de l’auteur, à substituer « les dynamiques aux territoires ».
Savant, documenté, traitant des aspects tant historiques, épistémologiques et théoriques du sujet que de ses aspects pratiques et éthiques, ouvrant de larges perspectives de réflexion, un tel livre ne se résume pas aisément. Sa lecture est ardue, elle n’en est pas moins une expérience pleine de sens.
L’un des chapitres s’intitule « Loin des machines ». Il est particulièrement révélateur. L’abandon de la vision d’un vivant statiquement organisé, univoquement programmé par un génome fixe, oblige à abandonner aussi la métaphore machiniste. Autrement dit : l’homme n’est pas une machine. Les mécanismes à l’œuvre à l’intérieur des cellules comme entre les cellules répondent naturellement aux lois de la physique et de la chimie mais un organisme vivant, à la différence d’une machine, a une histoire, chacun de ses composants a une histoire, leurs génomes ont une histoire, une histoire de plusieurs milliards d’années ; en outre, cet organisme vivant a d’innombrables et indispensables échanges avec son milieu, avec les organismes qui l’entourent, avec ceux qui le parasitent et avec ceux qu’il parasite, etc., le tout en perpétuelle évolution... Rien à voir donc avec une machine, aussi élaborée soit-elle. Les deux ne sont pas de même nature. Ce constat invite à s’interroger sur bien des démarches éthiques, sur le bien-fondé de bien des projets.
Il s’agit bien d’un regard original, plein de promesse, sur le vivant, et partant, sur la vie et sur le monde.
Marc Lachièze-Rey
(Le Pommier, 2019, 156 p. 10€)
 Le vide, c’est ce qui reste quand on a tout enlevé. Cela paraît simple. Mais on s’aperçoit vite que le diable est dans les détails. Si l’on vide une cruche d’eau, elle est encore remplie d’air. Si l’on pompe l’air hors de la cruche, elle est encore traversée de rayonnements émis par les parois, sauf si celles-ci sont à la température du zéro absolu, ce qui est impossible. Le vide véritable n’existe pas. Il s’agit seulement d’un concept, lequel a traversé l’histoire des sciences et reste aujourd’hui fondamental dans la physique moderne.
Le vide, c’est ce qui reste quand on a tout enlevé. Cela paraît simple. Mais on s’aperçoit vite que le diable est dans les détails. Si l’on vide une cruche d’eau, elle est encore remplie d’air. Si l’on pompe l’air hors de la cruche, elle est encore traversée de rayonnements émis par les parois, sauf si celles-ci sont à la température du zéro absolu, ce qui est impossible. Le vide véritable n’existe pas. Il s’agit seulement d’un concept, lequel a traversé l’histoire des sciences et reste aujourd’hui fondamental dans la physique moderne.
Le livre du physicien Marc Lachièze-Rey (qui vient de paraître en seconde édition après celle de 2005) est une réflexion sur le concept du vide. Dans un survol de l’histoire de la physique, l’auteur traque le vide, mais aussi ses avatars ou réincarnations multiples. Car lorsque le vide est réfuté, il réapparaît sous une autre forme. Aristote rejette le vide des atomistes, mais il adopte le concept d’éther et de cinquième élément ou quintessence. Newton refuse l’éther luminifère de Huygens mais il évoque « un esprit subtil qui pénètre tous les corps » pour transmettre l’action à distance de la gravitation. Le vide est un joker auquel on fait appel pour résoudre un problème insoluble !
Dans la foulée d’Aristote, l’Eglise s’est longtemps opposée au concept du vide. Au XVIIe siècle, elle se heurte à des penseurs tels que Bruno et Gassendi, et aux premiers expérimentateurs : Toricelli, Boyle, Pascal, Von Guericke. Plus tard, Maxwell introduit le concept de champ électromagnétique. Le vide se définit alors comme absence de matière et de champ.
Puis vient le vide de la relativité. Il joue un rôle dans le repérage des mouvements. L’auteur nous explique de façon très convaincante que le vide ne peut être que l’état de symétrie maximale. Einstein fait le ménage dans les avatars du vide. Avec la relativité restreinte (1905), c’est l’éther électromagnétique qui disparaît, « une hypothèse superflue ». Avec la relativité générale (1915), c’est au tour de l’éther gravitationnel de Newton de succomber. Le vide devient alors l’espace-temps lorsqu’il est dépourvu de toute source (matière ou énergie). Sa courbure est-elle nulle ? Le sujet est toujours débattu.
On passe au vide quantique. Le monde matériel est constitué d’une superposition de champs quantiques (électromagnétique, électronique, quarks), qui se répartissent dans la totalité de l’espace-temps. On parle de vide quantique lorsque chaque champ est à symétrie maximale et à énergie minimale. Le vide pour un observateur ne l’est pas nécessairement pour un autre. Le vide peut servir de banque d’énergie où des particules virtuelles empruntent au vide l’énergie nécessaire à leur apparition et la rendent en disparaissant. Ce sont-là quelques-unes des bizarreries de la physique quantique.
Dans un dernier chapitre, M. Lachièze-Rey aborde le vide en relation avec la cosmologie. Il raconte la fameuse saga de la « constante cosmologique », une composante répulsive de la gravitation, qu’Einstein ajoute, à contrecœur, en 1917, à ses équations, de façon à décrire un Univers qu’il croyait statique. « La plus grosse erreur de ma vie », dira Einstein. Lorsque Hubble découvre, en 1930, l’expansion de l’Univers, Einstein s’empresse de supprimer sa constante, malgré l’avis contraire de Lemaître. Plus récemment, dans les années quatre-vingt-dix, on découvre avec surprise que l’expansion s’accélère, ce qui est contraire aux attentes, et à la théorie d’Einstein. D’où un nouveau débat : faut-il rétablir la constante cosmologique ? ou bien introduire le concept de l’énergie sombre, avec une toute nouvelle physique ? L’auteur favorise la première solution. Ces deux solutions font appel à des avatars différents du vide. Le débat se poursuit.
A la fin de son livre, l’auteur se lance dans une vive critique du concept de « l’inflation », cette phase d’accélération gigantesque de l’expansion juste après le Big Bang, communément proposée dans les modèles de cosmologie, qui donne lieu à une multitude de variantes. Il ironise en les comparant aux épicycles que Ptolémée ajoutait pour faire coller à la réalité sa (fausse) théorie du mouvement circulaire des planètes autour de la Terre !
Le livre n’est pas d’un abord facile pour le lecteur moyen, en dehors de la partie qui concerne la physique classique (20 pages sur 140). L’ouvrage est dense : aucune phrase n’est superflue. Comme dans ses cours, Marc Lachièze-Rey déroule tranquillement son propos, avec son style fluide, sobre et rigoureux, sans artifice, ni formule-choc. Le lecteur, même profane, peut se laisser guider et assimiler lentement les concepts, présentés sans formule mathématique. En refermant le livre, on aura le sentiment, certes de n’avoir peut-être pas tout compris, mais surtout d’avoir grandement amélioré sa connaissance et sa compréhension du vide et des théories de la physique contemporaine.
Frédéric Thomas
(Humensciences, 2019, 320 p. 22€)
 « Si le cancer nous tue, c'est parce que nous ne sommes pas encore capables de gouverner son évolution. »
« Si le cancer nous tue, c'est parce que nous ne sommes pas encore capables de gouverner son évolution. »
Dans son livre L’abominable secret du cancer, Frédéric Thomas, biologiste de l'évolution, fournit un nouveau prisme pour comprendre cette maladie et comprendre pourquoi le cancer fait de la résistance.
Ce livre, comme l’écrit le Pr Pascal Pujol, chef du service d’oncogénétique du CHU de Montpellier et auteur de la préface, est « un livre scientifiquement lumineux et porteur de vrais espoirs ».
Fréderic Thomas est directeur de recherche au CNRS, basé à l'UMR MIVEGEC (Maladies infectieuses et vecteurs : écologie, génétique, évolution et contrôle) et co-directeur du CREEC (Centre de recherches écologiques et évolutives sur le cancer).
Si l’image de la couverture, un crabe bleu et cinq dessins d’un singe s’humanisant pour devenir Homo sapiens, m’a étonnée – mais l’éditeur explique ce choix en page 2 du livre –, j’ai été plus que conquise par cette conception assez révolutionnaire pour comprendre cette maladie.
Le cancer, c’est en 2017 en France, près de 400 000 nouveaux cas et 150 000 décès selon l’Institut national du cancer.
Apparu il y a plus d'un demi-milliard d'années, au Précambrien, le cancer est un processus écologique qui a accompagné l'évolution de nombreux organismes animaux, dont l’espèce humaine, et d’organismes végétaux (ces derniers sont peu traités dans l'ouvrage).
L’apparition de la multicellularité à l’époque du Précambrien est le résultat d’une coopération cellulaire, et cela procure des bénéfices. Cette multicellularité s’accompagne d’un risque de cancer. Au sein d’un organisme pluricellulaire, le cancer apparaît quand une cellule cesse de coopérer et de remplir les tâches qui sont les siennes au sein du système collectif. Elle devient (redevient ?) non coopératrice, « égoïste » comme le note l’auteur, et une fois présente, comme tout organisme, elle tente de survivre et de se répliquer.
En vingt-et-un chapitres, parfois très courts (chapitre 11 : Un mécanisme pervers, six pages) ou plus longs (chapitre 14 : Pourquoi les cancers sont ils plus fréquents qu’avant ?, une quinzaine de pages), l’auteur présente des concepts modernes et souvent nouveaux sur cette maladie. Le dernier chapitre traite spécifiquement des nouvelles pistes thérapeutiques.
Et au final, quelles sont les armes proposées par la théorie de l’évolution pour lutter contre le cancer ? On parle ici de thérapie adaptative. A condition de gérer son évolution, il faut prendre en compte le cancer, processus évolutif, difficile à éradiquer, et l’amener à un point d’équilibre au sein de l’organisme. L’auteur explique de façon simple et accessible pourquoi la théorie de l’évolution de Darwin, vieille de 150 ans, pourra permettre de vaincre le cancer.
Muriel Florin
(CNRS Editions, Collection Biblis, 2019, 336 p. 10€)
 Ce livre, édité par le CNRS, est l’œuvre de Muriel Florin, journaliste au Progrès de Lyon.
Ce livre, édité par le CNRS, est l’œuvre de Muriel Florin, journaliste au Progrès de Lyon.
Il reprend exactement la formule de l’émission de Noëlle Bréham le dimanche à 19h30 sur France Inter : Maman, les p’tits bateaux. Des gens (des enfants sur France Inter, sans précision dans ce livre) posent des questions plus ou moins tirées de la vie courante (5 par semaine sur France Inter, 87 dans ce livre) et des scientifiques répondent de manière concise et fondée sans faire usage de chiffres ni de dessins (évident à la radio, un choix dans ce livre).
Les questions sont toujours judicieuses et les réponses sont toujours adéquates. Comme c’est le CNRS qui est à la manœuvre, les scientifiques sélectionnés sont toujours des chercheurs universitaires. Noëlle Bréham est plus éclectique sur ce point et ose parfois les sujets religieux par exemple.
Pas mal de thèmes sont bien vus et bien traités, par exemple :
- les référentiels galiléens ou pas,
- les trous dans le fromage,
- la comparaison des comportements des chats et des chiens (pratiquement impossible de dresser un chat),
- la manière d’évaluer les capacités cognitives des animaux,
- la prétendue bosse des maths,
- et beaucoup d’autres.
Le parti pris délibéré d’éviter les chiffres se fait sentir quand il est question de coups de soleil et d’UV A et B. C’est un choix, il faut rester cohérent. Mais en revanche, l’article sur le mètre est bien documenté sur ce point. De même, parler d’optique sans faire de dessin fait assez challenge.
Tout le monde peut trouver quelque chose à apprendre, par exemple que le sel fait fondre la glace car les grains s’entourent d’une pellicule d’eau mais aussi que les fourmis ne se constituent pas de réserves de nourriture et tant pis pour La Fontaine !
Bref, un bon livre, intéressant à lire, pas forcément d’un seul trait (c’est une compilation d’articles du journal Le Progrès) mais avec un intérêt jamais démenti, malgré quelques bizarreries comme les rayons refroidissants émis par la voûte céleste bleue. On demande à voir !
Jérôme Gavin, Alain Schärlig
(Presses polytechniques et universitaires romandes, 2019, 148 p. 23,60€)
 Aussi incroyable que cela puisse paraître, en Europe, au temps de la Renaissance, on était incapable d’additionner deux nombres par écrit ! Les marchands et comptables utilisaient encore les chiffres romains, impropres au calcul. La moindre addition nécessitait l’usage de jetons que l’on déplaçait sur un tableau, « une table de compte », selon des règles définies.
Aussi incroyable que cela puisse paraître, en Europe, au temps de la Renaissance, on était incapable d’additionner deux nombres par écrit ! Les marchands et comptables utilisaient encore les chiffres romains, impropres au calcul. La moindre addition nécessitait l’usage de jetons que l’on déplaçait sur un tableau, « une table de compte », selon des règles définies.
Pourtant depuis le IXesiècle, à Bagdad, on avait peu à peu mis au point un système de numération par position, basé sur des chiffres venus d’Inde, dits arabes, incluant le zéro, qui permettait de faire des calculs par écrit pour les quatre opérations élémentaires avec une efficacité nettement supérieure. C’est également à cette époque et en ces lieux que l’algèbre fut inventée.
Ce petit livre de 140 pages s’inscrit dans l’histoire de la lente introduction en Europe des chiffres arabes, du calcul écrit et de l’algèbre. Les auteurs, Jérôme Gavin et Alain Schärlig, sont des spécialistes de l’histoire du calcul, cette frange méconnue de l’histoire des sciences. Ils nous invitent à « une promenade » de huit siècles, de 800 à 1600, sans prétendre à aucune exhaustivité, et en se limitant, pour des raisons de simplicité, à l’opération la plus simple, l’addition.
En 800, début de la promenade, nous découvrons Alcuin, le conseiller de Charlemagne : il rénove l’enseignement de l’arithmétique, mais on est encore très loin du calcul écrit. Il a laissé des problèmes qui sont devenus des classiques comme celui de l’échelle à 100 barreaux (que, 1000 ans plus tard, l’enfant Gauss résoudra seul, selon la légende).
En l’an 1000, c’est le pape Sylvestre II (Gerbert d’Aurillac) qui occupe la scène. Mais sa réputation d’introducteur des chiffres arabes en Occident serait, selon les auteurs, usurpée.
Les auteurs nous présentent ensuite les sept « pères du calcul écrit », qu’ils ont sélectionnés pour avoir marqué l’histoire du calcul. Chaque père a droit à un chapitre qui se clôt avec cinq problèmes d’arithmétique choisis dans son œuvre.
Le père fondateur est Léonard de Pise, celui qui a tout déclenché (1202). Il a voyagé dans les pays arabes et a décelé l’extraordinaire potentiel de leur système de numération. Sa notoriété ne viendra pourtant qu’au XIXe siècle, sous un faux nom et pour une fausse raison (la fameuse suite de Fibonacci, résultant d’un calcul anodin de descendance de lapins !).
Les autres pères sont de parfaits inconnus pour le profane. Chacun apporte sa brique à l’édifice du calcul écrit et contribue à la propagation de cette nouvelle technique : le Français Chuquet (1484), victime d’un plagiat découvert au XIXe siècle ! L’Allemand Widmann (1489), qui invente les signes + et -, mais avec un sens un peu différent du nôtre. L’Italien Pacioli (1494), qui touche à l’algèbre et appelle l’inconnue « la chose » (cosa). L’Allemand Ries (1522), le professionnel, « maître de calcul », édité 100 fois en un siècle ! L’Anglais Recorde (1543), qui a inventé le signe =. Le Suisse Von Graffenried (1619), qui utilise les nombres décimaux.
Le moins que l’on puisse dire est que ces nouvelles « technologies », chiffres arabes et algèbre, ne se sont pas propagées en Europe comme une traînée de poudre, malgré leurs énormes avantages. Le calcul écrit ne commence qu’au XIVe siècle pour les marchands italiens, au XVe en Allemagne, et bien plus tard partout ailleurs. En 1612, les comptes de la ville de Thoune en Suisse sont encore en chiffres romains, soit quatre siècles après Léonard !
Bien qu’inventée au IXe siècle, l’algèbre n’est presque pas utilisée pour la résolution de problèmes. Tous les pères montrent encore une nette préférence pour la vieille règle regula falsi qui consiste à tester une solution délibérément fausse pour en déduire la vraie. Et on est encore loin à cette époque d’écrire des équations. Tout est décrit sous forme de textes.
Ce livre est d’une lecture facile et agréable. Des extraits de textes en vieux français nous sont présentés pour en apprécier la saveur, ainsi que des photos de manuscrits. La présentation des 40 problèmes d’arithmétique est amusante et les solutions élégantes forcent l’admiration. Certains font penser aux problèmes de robinet de notre enfance !
Avec ce livre, on plonge dans une époque lointaine, avec ses connaissances, ses traditions, ses façons de raisonner. En découvrant les solutions des problèmes, on ne peut s’empêcher de penser que l’algèbre aurait été plus efficace. De même, les signes +, -, ou = nous paraissent si évidents que l’on se demande pourquoi ils n’ont pas été inventés plus tôt ! Ces impressions viennent évidemment d’une erreur de perspective : notre jugement est biaisé par nos connaissances d’aujourd’hui. Et c’est une leçon importante que les auteurs ont rappelée dans leur conclusion : en histoire des sciences, la règle cardinale est d’observer le passé, et uniquement le passé, en faisant abstraction de nos connaissances présentes.
Arnaud Guérin
(Glénat et Arte Editions, 2019, 192 p. 35€)
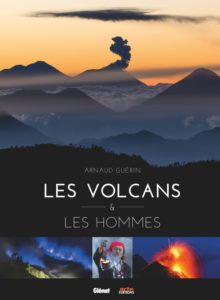 Pour nous tous, les volcans ont un intérêt scientifique, mais aussi esthétique car ils font l’objet de magnifiques photos depuis, entre autres, Les rendez-vous du diable d'Haroun Tazieff dans les années soixante. La chaîne Arte a diffusé sur ce sujet une série documentaire, Des volcans et des hommes, confiée au géologue et photographe Arnaud Guérin. Vingt films de vingt-six minutes ont été tournés dans onze pays et sur plus de vingt volcans actifs. Au-delà de l'aspect scientifique, Arnaud Guérin s’est intéressé au lien des hommes avec cet aspect grandiose des forces de la nature. De toute cette matière, il a tiré un livre magnifiquement illustré qui nous permet de suivre tout autour du monde le phénomène géologique mais aussi sa relation avec l'activité humaine.
Pour nous tous, les volcans ont un intérêt scientifique, mais aussi esthétique car ils font l’objet de magnifiques photos depuis, entre autres, Les rendez-vous du diable d'Haroun Tazieff dans les années soixante. La chaîne Arte a diffusé sur ce sujet une série documentaire, Des volcans et des hommes, confiée au géologue et photographe Arnaud Guérin. Vingt films de vingt-six minutes ont été tournés dans onze pays et sur plus de vingt volcans actifs. Au-delà de l'aspect scientifique, Arnaud Guérin s’est intéressé au lien des hommes avec cet aspect grandiose des forces de la nature. De toute cette matière, il a tiré un livre magnifiquement illustré qui nous permet de suivre tout autour du monde le phénomène géologique mais aussi sa relation avec l'activité humaine.
Le livre est constitué de deux parties.
La première concerne la vie avec les volcans. Après une explication pédagogique sur les causes de l'existence des volcans et la relation complexe qui les lie aux hommes vivant à proximité, on passe en revue les divers phénomènes, depuis les bombes et les cendres jusqu'aux geysers. On y découvre aussi l'existence d'une vie extrêmophile qui explique peut-être les débuts de la vie sur terre.
La deuxième partie, plus importante en volume, est consacrée à l'histoire de la relation de l'Homme avec les volcans. On y trouve des coutumes étonnantes : par exemple la pratique japonaise du sunamushi qui consiste à se recouvrir de cendres volcaniques dont la température dépasse 80 °C, ou la vénération de sainte Agathe en Sicile. La relation avec le volcan peut être aussi utilitaire, avec les mines de soufre en Indonésie, l'extraction de la pierre de Volvic en France ou, au Japon, l'obtention des plus gros radis du monde.
Le livre d'Arnaud Guérin nous offre un magnifique voyage autour du monde et peut être lu avec beaucoup d'intérêt par des non spécialistes mais aussi par un public averti.
Marcus du Sautoy
(Flammarion, 2019, 608 p. 12€)
 A partir des grandes questions scientifiques, des grandes énigmes telles que «L'Univers est-il infini ?», «La matière peut-elle être décomposée en des morceaux infiniment petits ?», «Le temps a-t-il eu un début ?», «Qu'est-ce que la conscience ?»..., l'auteur nous emmène, à partir d'une simple question sur un dé rouge rapporté de Las Vegas, dans une promenade étourdissante au milieu des découvertes scientifiques anciennes ou récentes qui ont permis à la science de progresser.
A partir des grandes questions scientifiques, des grandes énigmes telles que «L'Univers est-il infini ?», «La matière peut-elle être décomposée en des morceaux infiniment petits ?», «Le temps a-t-il eu un début ?», «Qu'est-ce que la conscience ?»..., l'auteur nous emmène, à partir d'une simple question sur un dé rouge rapporté de Las Vegas, dans une promenade étourdissante au milieu des découvertes scientifiques anciennes ou récentes qui ont permis à la science de progresser.
Il en profite pour nous faire toucher du doigt tout ce que nous ne savons pas encore expliquer et que nous ne saurons probablement jamais ! En revanche cette balade lui permet de dresser un état des connaissances particulièrement complet et clair, malgré la difficulté d'aborder les concept de la physique quantique !
Ce livre est écrit avec humour et légèreté, ce qui le rend particulièrement accessible.
Pierre Avenas
(EDP Sciences, 2019, 272 p. 19€)
avec la collaboration de Minh-Thu Dinh-Audouin
 Quelle est l’origine du nom des éléments chimiques comme le cuivre, l’hydrogène, ou le sodium ? Voici des questions que l’on ne se pose pas nécessairement à priori. Et pourtant, les réponses sont passionnantes car elles nous emmènent au cœur de l’histoire de la découverte de ces éléments.
Quelle est l’origine du nom des éléments chimiques comme le cuivre, l’hydrogène, ou le sodium ? Voici des questions que l’on ne se pose pas nécessairement à priori. Et pourtant, les réponses sont passionnantes car elles nous emmènent au cœur de l’histoire de la découverte de ces éléments.
L’auteur, Pierre Avenas, est un chimiste professionnel, passionné d’étymologie. Il traite, un par un, tous les éléments du tableau périodique de Mendeleïev (90 naturels et 28 artificiels). Il poursuit ensuite avec d’autres «éléments», comme des molécules complexes, pour un grand total de 300 substances.
L’histoire des noms au cours des siècles ne connaît évidemment pas de frontières et ce sont donc les noms français, mais aussi anglais, allemands, espagnols, italiens, suédois, que l’auteur examine, avec leurs racines grecques, latines ou arabes ! L’auteur doit nous donner au passage quelques rudiments de linguistique sur les règles d’évolution des mots dans les différentes langues. Ces explications peuvent parfois alourdir un peu la lecture du texte, mais l’auteur, sans doute conscient de cet écueil, nous donne des petits tableaux de synthèse résumés que le lecteur appréciera.
La mythologie joue un grand rôle dans cette histoire. L’Antiquité avait identifié 7 métaux, que l’on associait aux 7 «planètes» de l’époque, elles-mêmes associées à 7 dieux de la mythologie, puis aux 7 jours de la semaine. Plus tard, on a gardé cette coutume d’utiliser la mythologie pour nommer les éléments. L’auteur nous propose une grille généalogique de la mythologie gréco-latine très pratique pour suivre ses explications. Les mythologies égyptienne et scandinave sont également sollicitées, ainsi que les lutins mineurs germaniques (les Nains de Blanche-Neige !).
Les noms des éléments viennent aussi des noms de lieux où l’élément a été découvert (le cuivre pour Chypre) ou du pays d’origine du découvreur. Une mini-guerre des noms franco-allemande eut lieu en 1877 qui se solda par deux nouveaux éléments : le gallium et le germanium. Les noms viennent aussi du nom de savants. Mention spéciale pour le meitnérium, seul nom d’élément associé à une femme, juste revanche pour Lise Meitner injustement écartée d’un prix Nobel accordé exclusivement à son partenaire masculin pour la découverte de la fission nucléaire.
Au fil de ces histoires, on découvre des informations inattendues et des anecdotes savoureuses.
Ainsi apprend-on que les Grecs pratiquaient déjà le foie gras ; que le phosphore a été découvert en 1669 par un alchimiste qui cherchait de l’or dans l’urine ! Que le mot porcelaine vient du mot porc. Que l’eau de Javel vient du lieudit «javelle», mot d’origine gauloise. Que Walt Disney a nommé le chien Pluto en l’honneur de la planète Pluton récemment découverte (1930).
On apprend aussi que le styrène, un produit de la pétrochimie, a fait l’objet d’un poème improbable de Raymond Queneau (1958) ! Pierre Avenas se permet d’ailleurs d’y ajouter deux alexandrins de son cru !
Dans son épilogue, l’auteur fait remarquer que la vie se contente de 6 éléments chimiques seulement pour construire tous les acides nucléiques, donc le code génétique, et toutes les protéines du monde vivant. Six sur un total de 90 éléments existant dans la nature !
On comprendra en lisant ces lignes et les quelques exemples qui ont été donnés, que ce livre est une source inépuisable d’informations les plus diverses, amusantes ou sérieuses. Les multiples petites histoires qui nous sont racontées nous font mieux comprendre l’histoire générale de la chimie et des sciences en général : «Toute l’histoire de l’humanité depuis les pigments des peintures pariétales jusqu’aux éléments radioactifs découverts récemment» écrit Jacques Livage dans sa préface.
Le livre est divisé en petits paragraphes courts, agrémentés de beaucoup de photos et d’illustrations, ce qui en rend la lecture très attrayante. Grâce à son index, ce livre peut être consulté facilement comme un petit dictionnaire.
Michel Chauvet
(Belin, 2018, 880 p. 69€)
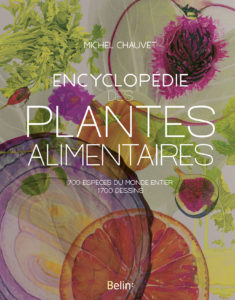 Cette importante encyclopédie nous décrit environ 670 espèces de plantes comestibles que l’on peut rencontrer dans le monde entier, qu’il s’agisse de fruits, de légumes, de plantes oléagineuses, de céréales, de tubercules, de plantes aromatiques, d’épices, de champignons, d’algues ou de plantes entrant dans la composition d'additifs industriels. Chaque plante est présentée sous ses différents noms (scientifiques, anciens, populaires ou selon les langues) avec différents paragraphes selon son importance (biologie, variétés, histoire, usages, économie). Plus de 1100 dessins en couleurs et 600 dessins au trait illustrent les espèces et leurs variétés. Certains aliments peuvent être cueillis dans la nature, d’autres seront sur les marchés du monde entier : plus de 340 cartes du monde montrent l’origine, l’histoire et la répartition actuelle des espèces.
Cette importante encyclopédie nous décrit environ 670 espèces de plantes comestibles que l’on peut rencontrer dans le monde entier, qu’il s’agisse de fruits, de légumes, de plantes oléagineuses, de céréales, de tubercules, de plantes aromatiques, d’épices, de champignons, d’algues ou de plantes entrant dans la composition d'additifs industriels. Chaque plante est présentée sous ses différents noms (scientifiques, anciens, populaires ou selon les langues) avec différents paragraphes selon son importance (biologie, variétés, histoire, usages, économie). Plus de 1100 dessins en couleurs et 600 dessins au trait illustrent les espèces et leurs variétés. Certains aliments peuvent être cueillis dans la nature, d’autres seront sur les marchés du monde entier : plus de 340 cartes du monde montrent l’origine, l’histoire et la répartition actuelle des espèces.
Avec la mondialisation des échanges, de nombreuses plantes exotiques peuvent être disponibles en Europe et cet ouvrage nous apporte ainsi une information précise et complète sur de nombreux aliments végétaux, quelle que soit leur origine géographique. On y retrouve aussi des plantes oubliées comme la manne terrestre, la graine de paradis ou le chervis.
Le travail minutieux réalisé par Michel Chauvet, ingénieur agronome et ethnobotaniste, ancien ingénieur de recherche à l'Inra (Institut national de recherche agronomique) mérite d’être félicité.
Notons que Michel Chauvet est aussi membre fondateur de l’association Tela Botanica, qui regroupe les botanistes francophones. Il a lancé le site web collaboratif sur les plantes utiles, Pl@ntUse, qu’il continue à animer.

